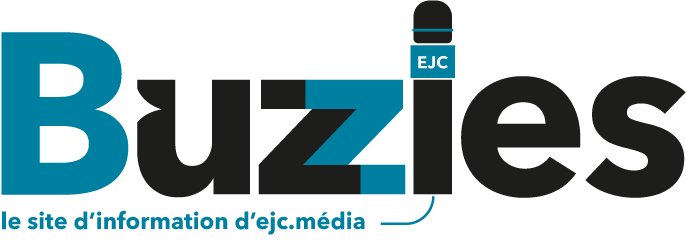La constitution de 2001 protège la liberté de la presse aux Comores. Depuis 17 ans, la charte déontologique de Hamramba a été adoptée. Pourtant, des journalistes comoriens déplorent une « autocensure permanente » à cause de pressions politiques.

Il en est tristement convaincu, « depuis 2016, le contexte politique embastille la presse ». Le journaliste Kamal’Eddine Saindou, membre du conseil national de la presse et de l’audiovisuel comorien CNPA, déplore un enrôlement politique et économique des médias. En 2016, le colonel Azali Assoumani avait remporté les présidentielles, il a été réélu le 14 janvier 2024 pour son quatrième mandat. Les médias publics comoriens, le journal Al-Watwan et l’entreprise nationale de radiotélévision ORTC ont une dépendance financière totale au gouvernement. Cette liaison rend « l’exercice d’un journalisme libre difficile », affirme Kamal’Eddine Saindou. Même si les textes de loi décrivent un contexte de liberté de la presse, pour Kamal’Eddine Saindou, la mise en œuvre est limitée.
Presse et pouvoir, intimement liés
« Les médias publics sont utilisés comme vitrine du pouvoir » déclare un journaliste d’Al-Watwan anciennement reporter à l’ORTC, qui a voulu témoigner anonymement. Nous l’appellerons Abdou Issouf. Leurs directeurs sont nommés par décrets présidentiels, ils « doivent prêter allégeance aux intérêts du gouvernement » assure le reporter. Le secrétaire de rédaction, désigné par le directeur recevrait selon le journaliste, des directives pour « filtrer tout ce qui est nuisible à l’image de l’État, tel un mercenaire ». Certains termes utilisés ou la formulation du titre pourraient empêcher la publication d’un article s’ils « posent un problème au pouvoir », juge le reporter. Parfois, l’article serait modifié pour « arrondir la critique » témoigne Abdou Issouf et il pourrait y avoir censure complète.
Abdillah Saandi Kemba, secrétaire de rédaction à Al-Watwan, estime que la 75e place dans le classement de la liberté de la presse « n’est pas une si mauvaise place » , par rapport à d’autres pays voisins. Il reconnaît qu’il « faut être redevable » vis-à-vis de l’État dans son journal. Mais il souligne que « seulement 2 ou 3 % des articles sont censurés » , quand il n’y a pas la parole officielle de représentée. On ne peut pas parler du président sans une intervention du porte-parole du gouvernement, illustre-t-il. « En tant que média officiel, uniquement des articles équilibrés » doivent être publiés, atteste Abdillah Saandi Kemba. Selon Abdou Issouf, ce que le secrétaire de rédaction appelle un article équilibré est « un article qui comporte un avis en faveur du gouvernement et éventuellement un regard de l’opposition ».
Abdou Moustoifa, reporter à Al-Watwan, correspondant à Reuters, à El Pais et à Hebdo Mayotte, s’est vu refusé de publier à Al-Watwan un article sur une controverse impliquant le président. « On doit chercher des interlocuteurs du gouvernement, on ne peut pas interviewer qui on veut », déplore-t-il. Avant les élections présidentielles, il avait fait un article sur le congé présidentiel obligatoire, non respecté, d’une durée de 75 heures avant la publication de la liste définitive. Cette entorse législative avait divisé la communauté des juristes. Pour espérer une publication, Abdou Moustoifa analyse qu’il lui aurait fallu « un entretien avec un juriste complaisant avec le pouvoir ».
L’islam sunnite est la religion de 98% de la population comorienne, c’est aussi celle du Président Azali Assoumani. « Il est impossible de traiter et de critiquer des institutions religieuses », confie le secrétaire de rédaction d’Al-Watwan. Des sujets décriés par les mœurs comme l’alcool ou la prostitution sont à proscrire. « La religion et la culture ont un fort impact » dans la liberté d’expression, constate-t-il.
Abdillah Saandi Kemba admet que les articles en faveur du gouvernement sont plus nombreux dans le journal Al-Watwan, mais que la critique est possible si elle est faite habilement, « c’est comme si on marchait sur des œufs » ajoute-t-il. Les informations gouvernementales représentent 60 à 70 % du journal. Le secrétaire de rédaction travaille à la création « d’un guide » pour expliquer aux jeunes journalistes de sa rédaction « quels termes il ne faut pas utiliser et quels sujets il ne faut pas traiter, pour les protéger » de répercussions judiciaires et financières. Mais pour lui, le problème n’est pas dans la censure, mais dans l’autocensure. « Ici, on a peur de dire les choses parce qu’on a peur de voir notre carrière se briser », confia-t-il.
« L’autocensure permanente » en prévention de la censure
Les six journalistes interrogés s’accordent sur un fait : « l’autocensure est permanente » . Mariata Moussa, ancienne rédactrice en chef d’Al-Watwan et secrétaire générale du CNPAC s’insurge que « beaucoup de journalistes se livrent à l’autocensure par peur d’être inquiétés, d’être interpellés et placés en détention. Il y a des intimidations qu’on rencontre au quotidien dans l’exercice de notre travail. Et ça, c’est grave pour la liberté de la presse », déclare-t-elle. Pour Abdou Moustoifa, l’autocensure permet d’être publié : « si on ne se soumet pas à ce qui est attendu, nos papiers peuvent ne pas sortir ». Il n’y a pas d’interdictions systématiques établies dans les rédactions, mais Abdillah Saandi Kemba signale « qu’une fois l’article publié, les autorités peuvent protester s’il ne convient pas ».
L’intimidation des journalistes peut passer par des courriers du ministre de l’Intérieur témoigne Kamal Saindou. Si un article déplaît, « il faut se soumettre ou se démettre » résume le coordinateur du CNPAC. Les désapprobations de l’État ne sont pas toujours rapportées officiellement, expose le reporter d’Al-Watwan Abdou Issouf, elles peuvent être « transmises par des personnes commissionnées ».
Sanctions judiciaires et financières
La pression des autorités politiques peut conclure à des répercussions judiciaires, plus de la moitié des journalistes sollicités en ont fait l’expérience : suspension d’emploi, interpellation, garde à vue ou emprisonnement. Mariata Moussa, révoltée, ne supporte pas l’idée « qu’ à tout moment les forces de l’ordre peuvent poursuivre des journalistes parce qu’ils exercent leur métier ». En tant que secrétaire générale, elle plaide au nom du CNPAC pour la lutte contre la pénalisation des délits de presse : « Le jour où on obtiendra la dépénalisation du délit de presse, ça sera un pas vers la liberté d’expression et de la liberté de la presse », promet-elle.
Le correspondant à Reuters, Abdou Moustoifa, certifie que les ponctions et rétentions de salaires sont courantes à l’ORTC et à Al-Watwan pour sanctionner des journalistes qui ont déplu au gouvernement. Son confrère Abdou Issouf, indique que « les journalistes ont conscience de cette pression financière ». La Gazette, un journal privé, voit ses publicités gouvernementales disparaître s’il produit un article « chaud », raconte-t-il. Or, « la presse libre est économiquement faible » regrette Kamal Saindou, coordinateur du CNPAC. La précarité amène les journalistes à céder à la tentation de recevoir de l’argent contre une couverture médiatique complaisante, déplore-t-il.
Au-delà des ponctions de salaire, le pouvoir public peut donner des consignes de licenciement d’un journaliste, soutien Abdou Issouf. « Ce n’est pas dans les textes de loi, mais ça se fait », reconnaît avec dépit le rédacteur d’Al-Watwan. Il raconte que le ministre du Sport avait demandé le départ d’un de ses confrères après la publication d’un article sur la gestion des athlètes et du dossier pour les Jeux olympiques. En réaction, le directeur du journal a congédié le journaliste pendant deux mois pour que « son nom n’apparaisse plus dans le journal, le temps de calmer le ministre », précise Abdou Issouf.
Des “petits gestes démocratiques” en périodes électorales

Kamal Ali, représentant du CNPAC, porte un regard critique sur la couverture médiatique des dernières élections en janvier 2024. Il y voit « des petits gestes démocratiques », mais il identifie « quelques dérapages des médias publics » et des « manquements à propos du temps d’antenne ». Au contraire, Abdou Issouf soutient que le gouvernement tenait à ce que l’opposition s’exprime dans les médias d’État. Il analyse cette stratégie comme « une arme de l’autorité pour brandir le fait que toutes les règles sont respectées ».
Un journaliste rapporte que le président de la commission électorale nationale aurait refusé l’accès de certains médias au Palais des peuples où le décompte des bulletins avait lieu. Ce ne serait pas le seul manquement à la liberté de la presse qui aurait marqué la fin de ces périodes électorales. Abdou Moustoifa relate des « coupures d’électricité volontaires de l’État » la veille et le jour de la diffusion des résultats pour « museler la couverture médiatique des manifestations », afin de « limiter l’encouragement à des protestations citoyennes ». Le correspondant à Reuters assimile ces événements à une atteinte à la liberté d’informer. Son confrère Abdillah Saandi Kemba souligne qu’il n’y a jamais eu d’articles sur les fonds de la présidence, il doute que cela puisse être possible dans le contexte politique actuel.
Dans un contexte où les journalistes ont les mains liées au pouvoir sous peine de sanctions, la presse ne peut être qualifiée ni de libre ni d’indépendante. Le syndicat national des journalistes et le CNPAC ont pour objectif de promouvoir la liberté de la presse. « Tant qu’il n’y en aura pas, on ne peut pas dire qu’on exerce le travail de journaliste » assène Mariata Moussa.
Nina Osmond
édité par C.R.
[RIG 2024] Union des Comores : une presse démunie
Censure, menaces et intimidations. Aux Comores, les arrestations de journalistes sont très fréquentes. Les médias publics peinent à être rentables. Leur dépendance totale vis-à-vis des subventions de l’État limite leur capacité à critiquer le régime en place, fragilisant ainsi leur liberté d’expression.
Pour lire notre long format, cliquez ici.
Une enquête réalisée par Nafida Abdillah, Estelle Fierling, Mathilde Georges,
Laura Khil, Nina Osmond & Romane Passet.