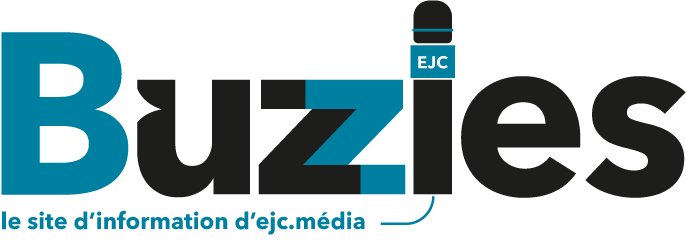Pour la plupart, ils n’ont pas connu la chute du mur de Berlin, ni le Traité de Maastricht. La construction de l’Union Européenne, ils l’ont étudié en cours d’Histoire. Malgré la situation actuelle, une jeunesse française croit encore en l’Union Européenne, et les arguments ne manquent pas.
Ils sont près de 100 millions sur le continent, ils représentent 20% de la population : les 15-29 ans sont une force pour l’Union Européenne. Et même si l’Europe est souvent remise en question aujourd’hui, à l’image de la Grande Bretagne et la Grèce, les jeunes Français y restent fidèles. Dans un sondage paru en décembre 2012, l’Institut Montaigne révèle qu’ils représentent la catégorie de population -avec les plus de 60 ans- « la plus attachée à la place de la France dans l’UE. » Pour eux, être européen est un facteur d’identité essentiel, plus encore que la religion ou l’appartenance ethnique. Ainsi, d’après la Fondation pour l’innovation politique (chiffres : 2011), 43% des jeunes Français admettent avoir confiance en l’Union Européenne. Ce taux avoisine même les 60% dans les douze nouveaux États comme la Roumanie et la Bulgarie.

Alors que l’euroscepticisme touche de plus en plus de Français, politisés ou non, les jeunes eux, prédisent un avenir prometteur à l’Europe. « Je ne peux penser l’avenir de la France qu’au travers de l’Union, déclare Jean, 19 ans, étudiant en sciences politiques à Nice. Ce n’est pas le moment de douter. La question européenne est une question primordiale pour l’avenir politique de notre pays. C’est dans la difficulté que le terme union prend tout son sens. »
Plus qu’une simple association d’États, elle leur apparait comme un tremplin idéal pour mener à bien leurs projets. « L’’Union européenne nous donne de nombreuses possibilités avec notamment des échanges internationaux et l’accès à l’éducation à l’étranger », affirme Corentin, jeune populaire (UMP) des Alpes-Maritimes. Toutefois, les Etats membres n’ont pris en compte les jeunes que très tardivement dans leur politique. Les premières références ont été introduites par le traité de Maastricht en 1992, pour « favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs ».
Par des actions ciblées, l’UE tente de développer la conscience européenne de ses futurs citoyens. En 1988 est lancé le programme Jeunesse pour l’Europe, dans le but d’encourager les échanges au sein des pays membres dans des domaines tels que l’éducation et la formation. Ils regroupent différents projets. Parmi eux, le programme Comenius, s’adressant à tous les acteurs de la vie éducative de la maternelle au secondaire, et le fameux Erasmus, destiné aux étudiants du supérieur. Les plus optimistes sont prêts à parier sur l’Europe, mais ils attendent qu’elle s’attarde sur les problématiques comme le développement durable, la préservation de la paix ou la place de l’Europe dans la mondialisation. Selon Sarah, lycéenne en classe de terminale à Cannes et adhérente au MoDem, « Les pays membres ne collaborent pas assez au niveau économique. La preuve, il y a une politique monétaire mais pas de politique budgétaire. Au G20 et au G8, l’Union Européenne n’est pas vraiment représentée. Chaque État vient seul. Les volontés d’union économique exprimées par le passé ne sont pas encore prêtes d’aboutir. » Une Europe basée sur le passé certes, mais qui se tourne essentiellement vers l’avenir. De quoi rallier les jeunes, qui veulent construire leur futur.
L’euroscepticisme gagne du terrain
Selon un sondage TNS Opinion pour la Fondation de l’innovation politique, publié en janvier 2011, 52% des Européens de 16 à 29 ans n’admettent pas le rôle de la dimension européenne dans leur identité. En plus de ne pas tous se sentir européens, leur confiance envers « les vingt-sept » est faible. Il n’y a pas d’étude sur les raisons précises de l’euroscepticisme chez les jeunes mais il peut être analysé d’un point de vue politique. Les jeunes Européens se détournent des mouvements classiques pour s’orienter vers des politiques moins conventionnelles, plus protestataires, qui se traduisent par une montée du radicalisme. Aleksandar Djordjevic, jeune étudiant slovaque de 21 ans, voit seulement en l’Europe une association sui generis*, et rien de plus : « les pays en Europe préfèrent s’occuper de la situation de leur pays. Cependant ils risquent, chacun, de faire basculer l’Europe. C’est le cas de la Hongrie avec Viktor Orban, celui de la Grèce où le Parti nazi est accepté au parlement… L’UE est en crise, mais il existe un contraste : d’un côté il y a l’Allemagne qui se porte plutôt bien, de l’autre les PIGS** et maintenant Chypre qui vont très mal. Pour le moment, l’UE n’est qu’un ensemble de pays, et non un seul pays ! »
* Construction politique et juridique « de son propre genre »
**Portugal, Ireland, Greece, Spain
« Impossible d’envisager la France sans l’Europe »
 Elise, 19 ans, élue présidente du MJS (Mouvement des Jeunes Socialistes) de Franche-Comté
Elise, 19 ans, élue présidente du MJS (Mouvement des Jeunes Socialistes) de Franche-Comté
« Aujourd’hui, on ne voit que les dérives libérales et une construction européenne basée uniquement sur des principes économiques. On a oublié la dimension politique du projet européen. L’UE permet de redorer le vieux continent sur l’échiquier international et dans le commerce mondial. Cependant, dans le contexte actuel, je pense qu’elle doit davantage servir les peuples européens, avant de peser mondialement. Impossible pour nous les jeunes d’envisager la France sans parler d’Europe. On a grandi avec elle ! Cette institution est entrée dans nos moeurs, dans nos programmes scolaires et dans nos actualités à la télé. C’est sans doute pour ça qu’on y croit, ou du moins qu’on y fait plus attention. On est la génération de l’Europe.«
« Je suis une citoyenne européenne »
 Lora, 23 ans, étudiante et immigrée Bulgare europhile.
Lora, 23 ans, étudiante et immigrée Bulgare europhile.
La Bulgarie, n’était pas encore rentrée dans l’Union européenne au moment où Lora est arrivée en France en 2002. A l’âge de douze ans elle explique qu’elle avait déjà conscience de la chance de cette ouverture des frontières. « Avant d’être Bulgare ou Française, je me sens citoyenne européenne » , déclare-t-elle. Être Européenne lui a permis de mieux s’intégrer en France, grâce « à cette culture commune ». Lora croit en cette Union : « Ayant vu les deux extrémités – de l’Est à l’Ouest, d’un pays démuni à un pays riche- je suis attachée à l’Europe et je crois à l’entraide qu’il peut exister. On a toujours l’impression que l’herbe est plus verte ailleurs mais, moi qui suis à l’intérieur du système, j’imagine de grands projets pour la suite. »
Vincent Bourquin, Léa Reguillot et Victor Vasseur
Traité de Maastricht