François Mattei est journaliste, grand reporter, ancien directeur de la rédaction de France-soir. Il a publié en juillet 2014 un livre polémique sur la crise ivoirienne de 2010-2011, suite à ses entretiens avec Laurent Gbagbo. Il y retrace une version de cette crise qui conteste la version officielle et met en évidence le rôle dominant de la France dans la région. Interview.
– La Françafrique, en 2014, qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des mécanismes de domination coloniale qui sont supposés avoir disparu, qui officiellement ont disparu, mais qui sont en fait masqués. Les piliers de la Françafrique existent bel et bien : présence militaire française en Afrique avec plus de 10 000 hommes et des interventions fréquentes, des accords de défense qui permettent cette présence militaire, la haute-main de la France sur le sous-sol de ces pays, par exemple pour l’uranium du Niger qui assure le quart de production électrique française, et le contrôle de la monnaie, le franc CFA, qui est imprimé en France, en Auvergne, et qui est géré par le Trésor public français. Aujourd’hui, la France prend 50 % des devis d’exportations de ces pays : ventes de cacao, café et minéraux, notamment, pour garantir la monnaie.

Que représente l’Afrique pour l’économie française ?
C’est un secret d’État ! C’est très difficile de savoir, les chiffres sont soigneusement dissimulés. Mais ce sont des sommes énormes, qui n’apparaissent pas dans les bilans publics de la Banque de France.
Vous avez publié l’été dernier un ouvrage « Pour la vérité et la justice. Côte d’Ivoire : révélations sur un scandale français », suite à vos entretiens avec Laurent Gbagbo, le président déchu, actuellement incarcéré à La Haye. Que s’est-il passé en Côte d’Ivoire lors des élections de 2010 ?
Les élections ivoiriennes ont eu lieu après des années d’attente. Laurent Gbagbo avait été élu en 2000. Après quoi, il y a eu quatre coups d’État, le plus important a été celui de 2002. S’en est suivi l’occupation par les forces rebelles de la partie nord du pays, soit 60 % du territoire ivoirien. Je montre dans mon livre les liens étroits entre Alassane Ouattara, l’actuel président, et la rébellion. La France, malgré les accords de défense, n’a rien fait pour chasser les rebelles. Il y a eu de nombreuses réunions pour régler la situation, et finalement Gbagbo, sous la pression de la France, a accepté que les rebelles entrent au gouvernement. En 2010, les élections sont convoquées, sans que les rebelles se soient désarmés, ce qui figurait dans les accords et dans les résolutions de l’ONU. Lors des élections il y a eu des fraudes, dans le Nord, avec des bureaux de vote où il y avait plus de voix que d’inscrits, et d’autres où personne n’avait voté pour Gbagbo, même pas son intervenant ! Cependant lors du premier tour, où Laurent Gbabgo sort vainqueur, il n’y a pas eu de contestation. Lors du deuxième tour, Alassane Ouattara est proclamé vainqueur par le président de la Commission électorale, dans un cadre polémique : la proclamation des résultats se fait au siège de campagne de Ouattara, avec la présence des ambassadeurs français et états-unien. Gbagbo et le Conseil constitutionnel ivoirien contestent cette élection.
Peut-on savoir qui a réellement remporté le scrutin ?
Comme en France, l’organe qui est chargé de trancher sur les différends électoraux, c’est le Conseil constitutionnel, qui s’est exprimé en faveur de Gbagbo. Quand Sarkozy a protesté contre le Conseil Constitutionnel français, qui a invalidé ses comptes de campagne, Hollande a dit que dans une démocratie on ne conteste pas l’organe suprême chargé de contrôler les élections. Alors pourquoi ne respectons-nous pas les institutions ivoiriennes ? J’ajouterai qu’en mai 2012, Henri Konan Bédié, troisième candidat au premier tour, a déclaré que les élections étaient truquées, et que c’était lui qui était arrivé en deuxième position lors du premier tour, ce qui aurait écarté Alassane Ouattara dès le premier tour.

Est-ce que vous craignez des troubles pour les élections qui sont prévues en Côte d’Ivoire en 2015 ?
D’abord il faut voir si elles sont finalement convoquées. Il va falloir une modification de la Constitution, puisqu’en l’état actuel, Alassane Ouattara n’est pas autorisé à s’y présenter, car il n’est pas reconnu par la loi comme Ivoirien. Alassane Ouattara a grandi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, et a fait une partie de sa vie avec un passeport burkinabè. En 2010, c’est une dérogation, faite par Gbagbo, qui lui a permis de se présenter. Le contexte actuel n’est pas très favorable aux révisions constitutionnelles visant à se maintenir au pouvoir. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il ne peut y avoir d’élections démocratiques tant que Gbagbo est en prison, tant que ses proches collaborateurs sont, par centaines, emprisonnés en Côte d’Ivoire et tant qu’il continue d’y avoir des milliers d’Ivoiriens réfugiés dans des camps dans les pays voisins. On ne peut donc pas envisager des élections très calmes.
Laurent Gbagbo est actuellement à la prison de la Haye, accusé de crimes contre l’humanité. Comment se déroule le procès ?
Amnesty International France a déclaré que lors de la crise ivoirienne, il y a eu des exactions de part et d’autre, mais que les poursuites ne se font que d’un seul côté, ce qui crée un sentiment de déséquilibre et de justice partiale et nuit à la réconciliation nationale. Laurent Gbagbo a demandé à ses partisans de rester pacifiques lors de la crise, pour éviter une guerre civile. Les seuls actes génocidaires prouvés à ce jour ont été commis par les rebelles. La Cour pénale internationale, dans le procès Gbagbo, répond à des intérêts politiques, et si elle condamne Gbagbo, sa légitimité en prendra un sacré coup.
Vous lancez des accusations très fortes dans votre livre : Patrick Ramaël, juge français en charge de l’affaire Kieffer (disparition d’un journaliste franco-canadien en CI lorsqu’il enquêtait sur la filière du cacao) serait devenu au cours de l’année 2013 un conseiller d’Alassane Ouattara. Bruno Clément-Bollée, patron de la Force Licorne [Forces françaises en Côte d’Ivoire] de 2007 à 2008, aurait décroché un contrat de conseiller spécial auprès de Ouattara. Enfin, l’ancien ambassadeur de France en CI, que vous qualifiez de « barbouze », serait devenu consultant « et passe sa vie dans la proximité immédiate d’Alassane Ouattara ». Ne craignez-vous pas d’être poursuivi pour diffamation ?
Je ne manifeste pas des opinions, je relate des faits. Donc je n’ai eu aucune poursuite en diffamation, et je ne les crains pas. Ces nominations en Afrique sont habituelles dans les hautes sphères politiques françaises et elles démontrent bien l’implication française dans la crise ivoirienne. Cette réalité concerne même les journalistes, un ancien directeur de France 24 ayant décroché un contrat pour restructurer la télévision ivoirienne.
En parlant de journalistes, pourquoi les médias français, pourtant bien présents en Afrique, évitent-ils de parler de cette situation ?
Les médias font partie de la Françafrique. RFI, France 24, TV5 Monde sont des organes rattachés au Quai d’Orsay. Les journalistes ne sont pas tout à fait libres. La preuve c’est que le représentant de RFI en Côte d’Ivoire lors de la crise de 2010-2011, a été suspendu d’antenne, il est revenu à Paris et est « au placard » encore aujourd’hui. Quant aux médias privés, ils appartiennent souvent à des industriels qui ont des intérêts en Afrique. Les journalistes chargés des rubriques africaines sont tenus de suivre la ligne politique du Quai d’Orsay, sinon ils sont coupés de l’informations. Globalement, pour devenir un bon journaliste expert sur l’Afrique, il faut suivre l’armée française quand elle est en mission. Car l’Afrique n’est traitée que quand il y a une intervention militaire française ou quand il y a des Français en otage, ou menacés. On traite rarement le fond. Alors que les Français ont besoin de savoir que l’Afrique noire non seulement ne leur coûte pas de l’argent, mais leur en fait gagner !
Vous affirmez également que « l’affaire ivoirienne est révélatrice des tares et dysfonctionnements de notre système politique en France, de son dévoiement au service d’intérêts particuliers ». Ne prenez-vous pas une position « anti-française » ?
Je suis souvent accusé d’être anti-français. On confond les intérêts de la France et les intérêts économiques de certaines entreprises françaises. Je comprends comment la Françafrique s’est créée : à la sortie de la guerre, De Gaulle a compris que la France allait devenir une puissance moyenne, comme l’Espagne et l’Italie. Le seul atout de la France c’était l’Afrique. Jacques Foccart, conseiller à l’Élysée aux affaires africaines, a mis en place un système de néocolonialisme, qui a permis à la France de conserver sa puissance mondiale. Et c’est parce que j’ai une haute estime de mon pays que je veux que cette situation change. La France du futur doit se construire sur autre chose que l’exploitation de l’Afrique.

Est-ce que vous avez une idée du rôle joué par l’Élysée dans le départ de Blaise Compaoré, après 27 ans à la tête du Burkina Faso ?
Je pense que l’Élysée a hésité. Mais finalement la pression de la rue était telle qu’ils lui ont conseillé de partir, et ils l’ont exfiltré vers la Côte d’Ivoire, chez Ouattara. Dans les anciennes colonies françaises, dès qu’il y a un événement politique majeur, il faut regarder vers Paris. Et dans ce cas, même si Blaise Compaoré était un allié de la France, l’Élysée ne pouvait pas cautionner la réforme constitutionnelle qui lui aurait permis de se présenter à nouveau. Il y a certaines choses qui ne sont plus tenables, car les nouvelles générations africaines ne marchent plus dans les mêmes combines : les jeunes sont de moins en moins francophiles. Mais la France résiste, et dans ce contexte, la lutte contre le terrorisme est une aubaine car elle justifie, à nouveau, la présence militaire française.
Propos recueillis par C.P
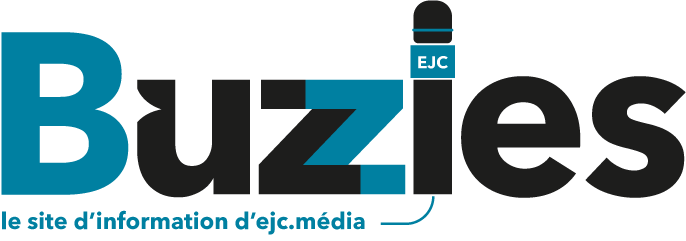
Beau sujet bien traité !
Le problème est qu’il y a tellement de non-dits, tellement de secrets d’État sur ce sujet qu’il est bien difficile de se faire une opinion, lorsque l’on méconnait l’Afrique. L’interventionnisme dans les affaires intérieures des pays, qui ne devrait pas avoir lieu, on est d’accord, est bien réel, d’ailleurs pas que pour la France, nos amis américains ne s’en privent pas ! Les chinois commencent à s’y essayer…
Deux points que je retiens de votre bel article :
– la presse (eh oui!) n’est pas « blanc bleu » ! Lors de l’élection de Ouattara, si j’ai bonne mémoire, on nous a présenté G’Babo que sous l’angle totalement négatif du Président génocidaire. Aujourd’hui, François Mattéi juge sa présence indispensable pour de prochaines élections démocratiques.Qui croire ?
– en matière monétaire, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Je ne connais pas le taux (vous dites 50%, c’est sans doute vrai) pris par la France sur les devises (c’est bien les devises) liées à l’export, mais la plupart de ces sommes sont des garanties, non des facturations. Elles restent donc la propriété des Etats, même si elles sont gelées. Le franc CFA, comme le pacifique ou le comorien, a eu sa justification. Le problème est que l’Euro est arrivé, et donc que le taux de change fixe qui était acceptable avec le FF devient moins justifiable avec l’euro compte tenu des différences économiques constatées entre les pays africains et les pays de la zone euro. Votre article m’a amené à rechercher un article ancien, sur ce thème. Cet article montre bien la limite du système et présente des variantes mis en œuvre de par le monde.
http://illassa-benoit.over-blog.com/article-14313794.html
J’aimeJ’aime
Bonjour,
merci de votre commentaire. En effet l’argent conservé par la Banque de France lié aux exportations est une garantie et non pas une facturation. C’est quand même des sommes (énormes?) d’argent qui sont gérées par la France.
J’aimeJ’aime