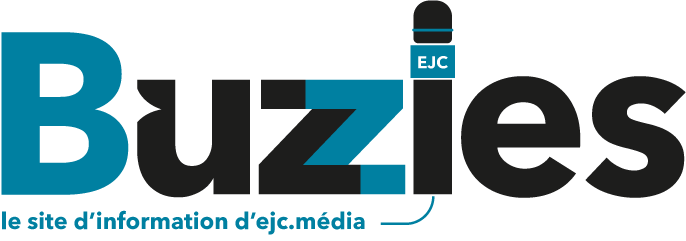Entre menace djihadiste et groupuscules à aspiration révolutionnaire, le pays fait face à une inquiétante montée de violence.
Dans les rues du Caire, des attentats visent les forces de police et l’armée. Jusqu’alors, ils étaient peu sophistiqués. Mais le 2 mars a marqué un tournant : une bombe placée devant la Cour de justice du Caire a explosé, faisant deux morts et neuf blessés, selon les derniers chiffres révélés par Libération (édition du 15 mars). Toujours selon le quotidien, cet évènement suit de quelques jours une série d’attentats à la bombe touchant la capitale égyptienne. Confirmation le 8 mars, où de nouvelles explosions ont eu lieu à Alexandrie. La diversité des groupuscules à l’origine de ces attaques préoccupe, d’autant plus que s’y adjoint une montée de l’Etat islamique.

Le plus menaçant, c’est bien sûr la branche de Daech qui prend pied en Afrique du Nord, et notamment en Libye. Rappelons que suite à la décapitation de 21 coptes égyptiens par l’Etat islamique, Abdel Fattah al Sissi, président égyptien, avait ordonné des bombardements dans les zones ciblées. D’autres branches djihadistes ont également été localisées dans le Sinaï, avec pour objectif d’instaurer un califat dans la région. Les choix géopolitiques de l’Egypte semblent l’enfermer.
Une jeunesse qui se radicalise
Parallèlement, d’autres groupuscules peu organisés commettent des attentats comme ceux du 2 mars, touchant principalement la capitale égyptienne. Mais s’ils sont souvent radicalisés, il serait erroné de penser qu’ils sont reliés aux branches djihadistes. Ces nombreux groupes, aux noms très explicites – Molotov, Wala’, Mouvement de la résistance populaire, Châtiment révolutionnaire – sont souvent composés de jeunes qui se sont radicalisés après la révolution de 2011. Pour le politologue Ashraf al-Chérif, interrogé par Libération, « Ce courant (…) a réussi à rassembler autour de lui un nombre important de jeunes, persuadés que le changement viendrait de la rue et non du jeu politique traditionnel. Mais après le départ de Morsi, une partie de ces jeunes s’est radicalisée, devenant adepte d’une violence tactique. »
Il faut savoir que depuis la chute de Morsi et des Frères musulmans en 2013, ainsi que l’arrivée d’Al-Sissi au pouvoir, le régime traite la confrérie d’une main de fer. Les cadres supérieurs ont été emprisonnés. Plus de 1400 manifestants pro-Morsi ont été tués depuis 2013, et on estime que 15 000 sympathisants islamistes sont gardés en prison (source: Libération, édition du 15 mars). Décentralisé, le mouvement n’a plus de réelle stratégie politique, ce qui ouvre la voie à cette multiplicité de groupuscules difficiles à appréhender.
Matthias Somm