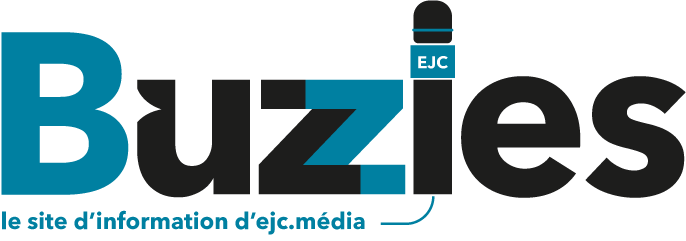Au-delà de la victoire de la droite, quelles leçons doit-on vraiment tirer des résultats des départementales, une semaine après les résultats du second tour?
Jamais la droite n’avait fait pareil score lors d’une élection locale. D’ailleurs, jamais aucune formation politique n’avait ravi tant de départements. La droite contrôlera (avec l’UMP, l’UDI et les affiliés DVD), à l’issue des élections des présidents des Conseils départementaux, 66 départements. La zone bleue est particulièrement impressionnante dans toute la partie est de la France, où seules la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Saône, historiquement à gauche, restent socialistes. Parmi les gros coups opérés par la droite, on peut citer les Côtes-d’Armor et le Nord, deux départements détenus par la gauche depuis plus de 35 ans. Le basculement à droite de la Corrèze, pointé par tous les spécialistes, ne reste cependant qu’une demi-surprise : si elle est le bastion de François Hollande, elle était aussi celui de Jacques Chirac, et n’est pas connue pour son fort ancrage à gauche. La considérable réussite de la droite aura été de mobiliser au second tour, afin de confirmer les résultats du premier. Nicolas Sarkozy, quant à lui, sort renforcé de cette élection. Bien qu’il refuse de s’ériger publiquement comme le grand gagnant, nul doute qu’en interne, l’ex-président jubile. Pourtant, selon un sondage paru dans le Figaro du 25 mars, 64% des sondés considèrent que la victoire de la droite n’est pas celle de Sarkozy.
La gauche regarde déjà devant
Certes, la défaite est rude, surtout en chiffres. Pas moins de 28 départements basculent à droite. Mais la majorité ne s’en émeut pas, bien trop préparée à cette déroute annoncée. Finalement, cette élection pourrait bien servir de crash-test avant les régionales, une dernière claque avant la reprise. Car cette claque pourrait bien inciter le gouvernement à de nouveau ratisser large au niveau des alliances, avec à la clé un possible retour des écologistes dans l’exécutif. Seul hic, le gouvernement actuel, qui analyse la défaite comme la conséquence d’une désunion, opère davantage un calcul mathématique qu’une entente politique. Car si Manuel Valls veut rassembler, il ne souhaite pas infléchir sa politique, politique qui est pourtant à l’origine de cette désunion. En coulisses, un goût amer de tractations, où l’idéologie est bien lointaine. Ainsi, le Premier ministre s’attire les foudres de l’aile gauche de son parti. Au final, seul Jean-Vincent Placé multiplie les courbettes pour obtenir un portefeuille.
Le Front National est-il vraiment gagnant ?
La réponse est clairement non. Ses scores sont très honorables, son ancrage local se renforce mais finalement, le FN ne compte que 62 élus (sur plus de 4000), et ne dirigera aucun département. Une défaite, surtout pour Marine Le Pen, qui espérait voir le Vaucluse ou l’Aisne basculer dans l’escarcelle de son parti jusqu’au dernier moment. Finalement, le FN n’a pas fait le poids. Le FN n’est donc pas le premier parti de France : deux fois moins de conseillers départementaux que le Parti communiste, pourtant inexistant médiatiquement.

Marine Le Pen dénonce le mode de scrutin, qui ne l’avantage pas. Malgré 25% des voix remportées, le FN ne compte que 1.5% des conseillers départementaux, et donc 0% des départements. Autre angle d’attaque de Marine Le Pen : les alliances. Celle entre l’UMP et l’UDI tout d’abord, mais surtout celle entre la droite et la gauche lors des seconds tours. Feignant de ne pas comprendre cette alliance de circonstance pour barrer la route à son nationalisme et son conservatisme exacerbés, Marine Le Pen y voit une énième preuve de connivence de « l’UMPS ».
L’inédite incertitude
Avec la montée du FN et sa victoire dans plusieurs cantons, trois départements (le Vaucluse, l’Aisne et le Gard) n’appartiennent pour l’instant ni à la droite, ni à la gauche. Il faudra attendre jeudi, et les ententes entre les partis, pour savoir qui gouvernera certains départements. Ainsi, par exemple, dans le Vaucluse, si le FN s’allie avec la Ligue du Sud, il détiendra dix sièges. Quant au PS, s’il parvient à trouver un terrain d’entente avec les Verts et le Front de Gauche, celui-ci détiendra douze sièges, tout comme l’UMP-DVD. Autant dire qu’aucune majorité ne se dégage clairement dans ce département, et que des accords seront nécessaires pour éviter tout blocage.
L’abstention toujours présente
Seulement 45.8 % des électeurs se sont rendus aux urnes pour ce second tour. Un chiffre encore très faible, qui s’explique de plusieurs manières. Bien sûr, d’une part, c’est la traditionnelle défiance des Français envers la politique qui continue de s’exprimer. Mais aussi le manque de communication autour de ces élections, qui n’ont pas touché une certaine partie de la population. Autre cause bien moins médiatisée : le discours de Nicolas Sarkozy. Souvent, lorsque le chef de l’UMP soutenait sa politique électorale du « ni FN ni PS », il oubliait d’ajouter que le non-choix entre les deux formations correspondait à un vote blanc, et non à une abstention. Une maladresse, dirons-nous, d’un homme politique censé sensibiliser la population au devoir du vote. Ainsi, l’électeur UMP qui décide de suivre les consignes du parti est incité à ne pas se déplacer. Même, d’ailleurs, pour voter blanc : pourquoi se déplacer alors que le vote blanc n’est pas analysé, et qu’une participation donnerait donc du crédit à la classe politique ? En allant voter blanc, l’électeur fait baisser le chiffre de l’abstention et fait briller ces hommes costumés, se félicitant d’une abstention qui baisse dès vingt heures sur les plateaux télé. Alors aujourd’hui, la vraie contestation, c’est l’abstention, aussi regrettable soit-elle.
Emmanuel Durget