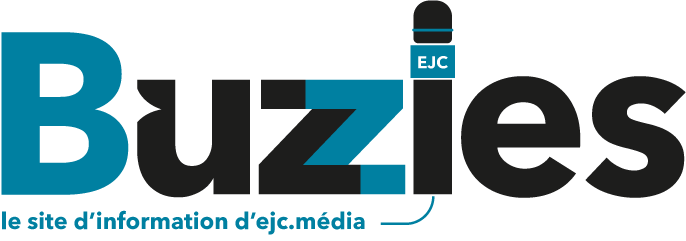A l’occasion de sa venue à Cannes, Fadette Drouard a accepté de se confier sur son métier de scénariste. Dernièrement à l’affiche avec le film Comme des Garçons, celle qui a écrit Patients évoque ses inspirations, ses méthode de travail ou encore son amour pour son métier, souvent trop peu reconnu.
Qu’est-ce qui vous a mené vers le monde du cinéma et plus précisément du scénario ?
Vaste question (rires), vers le monde du cinéma je vous avouerai que je ne saurais pas donner une raison particulière. Depuis que je suis toute petite, c’est le film, c’est raconter des histoires. Les images me hantent depuis très longtemps. Moi, je voulais être journaliste au cinéma, parce que je voulais faire partager aux autres ma passion du 7ème art, et c’est ce que j’ai fait. Puis un jour, j’ai croisé Ramzy et au fil de nos discussions, il m’a dit : « je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas du cinéma ? ». Je lui ai dit : « non mais arrête, moi faire du cinéma, bien sûr ! ». Et puis il s’est débrouillé pour me mettre un clavier dans les mains avec un film, et c’est là que j’ai commencé à écrire. Depuis, je n’ai pas lâché le clavier. Le cinéma est un média merveilleux, une des plus jolies façons pour raconter des histoires et au plus grand nombre. J’aime les univers, les belles histoires, qui ne sont pas forcément épiques. Ce peut être de petites histoires mais elles font de grands films. Ça a été en pleine conscience pour ce qui est la partie journalisme de cinéma et en pleine inconscience pour ce qui est de la partie scénario. Je me suis lancée et j’y suis restée.
D’où vous vient votre inspiration ?
De tout. Quand on est scénariste, on a toujours des histoires qui trainent derrière. On est tous pareils : on a tous un iPhone ou un carnet, et on prend des notes. Parce que ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y avait quelque chose qui tournait derrière, les tâches de fond, tous les scénarios sont déjà là. Et puis un jour, vous croisez quelqu’un dans la rue, et ce n’est pas forcément ce que la personne est en train de faire, mais ça vous fait penser à quelque chose d’autre, et vous vous dites : « enfaite c’est ça que je cherchais, c’est ça qu’il me fallait pour mon personnage ». C’est ça qui fait un scénario. On n’écrit jamais uniquement avec ce que l’on est, on s’inspire de ce que l’on voit, de ce que l’on a autour de nous, des gens que l’on connait, de ce qu’on lit. On ne peut pas écrire un scénario sans être extrêmement ouvert et curieux de la vie.
Et comment savez-vous quand un personnage est complet ?
Je ne sais pas, je vous le dirai si je savais. C’est un métier d’instinct entièrement. On ne peut pas dire à un peintre « comment tu sais que ton tableau est fini ? », moi c’est pareil je ne sais vraiment pas.
Patients et Comme des garçons font écho à des faits de société, comment transforme-t-on cela en œuvre cinématographique ?
Pour Patients, quand j’ai rencontré Fabien (Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade; ndlr), j’avais lu son livre bien avant, je savais bien évidemment qui c’était. On s’entendait bien, je me suis dit qu’on pouvait travailler ensemble. La première chose que je lui ai dit c’est : « je te préviens, on va faire du cinéma, le combat d’un homme pour devenir grand corps malade je m’en fous, je n’ai pas envie de raconter ça ». Il faut fictionnaliser parce que ce que l’on pose au cinéma doit être crédible mais pas forcément réaliste. On est obligé de jouer là-dessus pour que ce soit quelque chose que les spectateurs aient envie de voir. L’enjeu sur Patients, c’était aussi de faire une comédie, ce qui n’est pas forcément simple. Sur Comme des Garçons, on s’est dit que les femmes dont on parlait faisaient quelque chose d’incroyable. Mais on a beaucoup fictionnalisé parce qu’on ne savait pas vraiment qui elles étaient. Donc on s’est accordé cette liberté, de poser des choses qui ne sont pas forcément vrai. De toute façon on n’a pas le choix, on doit écrire, sinon on fait du documentaire. On essaie de se mettre à la place du spectateur et on se dit voilà : on fait du cinéma !
Comment fait-on passer l’émotion à travers l’écriture ?
S’il y avait une recette je vous la donnerais (rires). Je pense que c’est se dire : « moi qu’est ce qui m’émeut, me fait rire, est-ce que je pense que ça peut en émouvoir d’autres. De quel point de moi part cette émotion, est-ce que je peux reconnaitre cette émotion dans d’autres ». Il y a quelque chose d’un peu universel. Après on met les choses en place et on essaie de faire en sorte que le spectateur soit investi dans ce que l’on raconte. Le but du cinéma c’est d’emmener les gens. Quand il y a un énorme silence sur une scène avec beaucoup d’émotion, on comprend que le message est passé. Tout ce que l’on peut faire c’est essayer d’écrire au mieux. Le scénario ressemble parfois à la littérature, parfois à de la mise en scène. Sur Patients, il y a une scène que j’ai imposée à Fabien, car lui était très fort dans sa pudeur et il ne voulait pas rentrer dans des choses peut être plus dures. Dans une scène il se confie, j’avais besoin de voir ce personnage investit de quelque chose. C’est mon besoin d’auteur, mais aussi forcément un besoin de spectateur et d’acteur. C’est un peu ça que l’on cherche. On se rend compte à la lecture si ça ne marche pas, si l’acteur n’est pas touché par l’histoire qu’il va interpréter.
Quelle place prend le scénario dans la création d’un film ?
Pour moi, travailler un scénario au mieux, c’est construire avec la personne qui va le réaliser, la meilleure plateforme de laquelle il va pouvoir sauter. Quand on tourne, bien évidemment, d’autres problématiques se posent : acteurs, jeu, accidents de la vie, un décor pas comme si ou pas comme ça. Le tout en sachant qu’au montage on va encore pouvoir presque réécrire le film. En réalité, on a une base solide qui est le scénario et on n’a pas à se poser la question de si c’est cohérent, si ça bougera. Mon métier, c’est de poser cette base pour que les gens puissent se poser d’autres questions et qu’au tournage d’autres choses puissent être amenées qui vont pouvoir enrichir ce scénario. Au final, dans Patients, il y a plein de chose qui ont été tournées en plus, mais on revient très près du scénario original car c’est lui qui porte l’essence de notre idée de base. Une fois qu’on a sorti cette essence, cette plateforme, on peut aller un peu au-delà.
Trouvez-vous que le scénario est suffisamment reconnu dans le monde du cinéma ?
Ça dépend de qui on parle. Le grand public ne sait pas vraiment ce que l’on fait, et c’est normal, car il reçoit le film terminé. Il ne faut pas forcément qu’il ait conscience de tout ce que l’on a fait avant. Il consomme le produit finit. Quand je dis que je suis scénariste, on me dit : « ah bon ? mais tu fais quoi ? » et je leur réponds « et bien tout, les décors, les descriptions des personnages, les dialogues, les actions ». C’est vrai que les gens ne savent pas forcément et c’est normal. Mais j’ai la chance de travailler avec des gens qui valorisent ce travail là, qui en sont heureux. En France, et partout dans le monde d’ailleurs, on a un système où c’est le scénario qui permet d’aller chercher les fonds de production. On a donc tout intérêt à avoir un scénario béton pour pouvoir s’en sortir. On est tous très conscient de cela, que ce soit les réalisateurs, les producteurs ou même les acteurs. C’est très étrange, parce qu’on met beaucoup de cœur dans ce qu’on écrit, on parle de soi et de sa vision. Derrière il faut tout lâcher, ce qui est normal, car il faut que le réalisateur prenne sa place, qu’il reprenne un peu les choses en main, se réapproprie le matériau. Donc on a toujours un peu la trouille de voir le résultat final. En même temps, quand moi je me retrouve avec les réalisateurs, ils ne vont pas faire l’opposé de ce qu’on a travaillé, écrit. Après, oui, on laisse beaucoup de choses passer, c’est un métier où on a tendance à se dire : « je n’existe plus après ». Bien sûr qu’on existe, et quand moi je vois les films, je suis extrêmement fière. On est la première maille qui permet de faire exister le film.
Quel rapport le scénariste entretient-il avec son scénario ?
C’est très étrange, car c’est un métier de création. Donc c’est vrai qu’on écrit quelque chose où l’on met énormément de nous. Là où c’est rigolo, c’est qu’un écrivain qui fait ça et qui le lâche, à un retour direct sur son travail, moi j’ai un retour à travers un filtre. Mais on écrit un scénario et pas un roman. J’écris des films, des images donc quand elles arrivent sur l’écran, elles sont un peu à moi, je m’y retrouve. C’est très étrange d’aller sur un tournage où les personnages sont entrain de dire les dialogues que vous avez écrit, et c’est encore plus étrange de voir au cinéma notre écrit sur grand écran. Ce qui est encore pire que ça, une des réalisations complètes, c’est quand vous avez des gens qui ont vu le film et qui viennent vous en parler. C’est là que vous vous rendez compte qu’il n’est plus à vous, que les gens se le sont approprié et se sont investis dedans. L’écriture c’est une petite bulle et c’est super, tant que c’est que à nous. Mais en même temps, je ne peux pas me passer du regard de l’autre, d’acteurs, de producteurs, j’ai besoin de retours, de tester des choses que ce soit avec les uns ou avec les autres, avec ma petite sœur, ma grand-mère, ou mon producteur. J’ai besoin de ça. C’est très étrange le cinéma, on est entre la création et l’industrie, entre l’artisanat et l’art, on est toujours en mouvement entre ces deux pôles.
Vous êtes journaliste de formation. Qu’est-ce qui différencie l’écriture d’article de l’écriture d’un scénario ?
La fiction déjà. Mais je pense que je n’ai pas changé de style entre les deux. Personnellement, j’étais journaliste de cinéma, donc je parlais quand même de la mise en scène et de ces choses-là. Quand on écrit un scénario, on a un film dans sa tête et du coup on écrit le film qu’on est en train de s’imaginer. Je le décris au mieux pour que les gens puissent le comprendre et ensuite le réaliser. Très schizophrène comme métier (rires). Quand on est journaliste, on décrit quelque chose qu’on a vu, donc c’est un peu la même chose malgré tout. Vous avez l’intention de faire passer quelque chose aux autres, et je fais un petit peu la même chose dans le cinéma. Je décris des choses qui se passent dans ma tête, je vais finir en psy avec cette histoire (rires) pour que les autres puissent les lire et se les imagine. Donc c’est très bizarre, mais c’est ce que tous les gens qui écrivent font. Quand on est journaliste, on cherche à rester un peu objectif, raconter des faits et leur donner un peu de lumière et un point de vue, pour moi c’est à peu près le même métier.
Donc lorsque vous écrivez un scénario, c’est évident que vous avez déjà les images en tête…
Ah oui ! Moi je ne peux pas écrire une scène si je ne la vois pas. Chacun à sa façon de faire et quelque chose qui lui est propre mais moi j’ai besoin de voir la scène. J’ai besoin de voir les mouvements des personnages, leurs interactions, où ils sont pour pouvoir écrire ce que je dois écrire.
Quelle est la place du scénariste sur le plateau lors du tournage ?
On n’en a pas normalement. Si on a bien fait notre travail, tout est prêt pour que les autres puissent faire le leur. Après, on y va parce que ça fait plaisir, parce qu’on travaille pour ce moment-là, on retrouve les gens avec qui on a construit le projet. Mais il ne faut surtout pas se réinvestir là-dedans parce que ce n’est pas notre place. C’est le moment où le réalisateur doit prendre les choses en main. Donc j’imagine que ça doit être très frustrant si on se dit : « je vais aider ». Il faut se dire : « non, j’ai déjà aidé avant, mon travail a été fait ».
Avez-vous un droit de regard sur l’histoire ?
Non pas du tout, tout ce que je peux faire et j’espère que ça ne m’arrivera jamais, c’est enlever mon nom du film. Mais moi je travaille beaucoup avec les réalisateurs, donc il n’y a aucune raison que ça arrive.
Dans la pratique de ce métier, la passion tient-elle une place importante ?
Ah c’est entièrement par passion. Si je pensais que je pouvais être heureuse ailleurs en claquant des doigts, j’irais car il y a des jours où c’est vraiment compliqué. Et en même temps il y a des jours où tout va bien. On a parfois des petits moments de grâce, et on galère pendant des mois à côté. On est d’une résilience extrême et ces petits moments de grâce nous suffisent à tout oublier.
Marjolaine Baud-Laignier et Lou Florentin