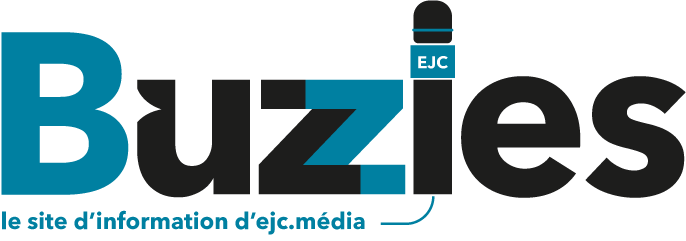Le cas Sharapova a relancé le débat. Chacun donne son avis et les accusations fusent sans preuves. Mais derrière ce capharnaüm, les pratiques de l’ITF sont à questionner.
C’est une image qui marque : les larmes de Maria Sharapova, l’une des plus grandes tenniswomen du XXIème siècle, popularisée par son talent précoce, son timbre de voix perçant lorsqu’elle frappe la balle, ou sa plastique dont elle a su profiter. « Maria », c’est aussi la gentillesse et la générosité d’une joueuse accessible, peu connue pour ses sautes d’humeur. Alors lorsque la droitière russe convoque la presse pour annoncer qu’elle a été contrôlée positif au meldonium, difficile de ne pas être ému. Pourtant, le produit comme les justifications de Maria Sharapova interrogent, tout comme la manière dont l’ITF (Fédération internationale de tennis) traite les contrôles positifs.
« L’affaire Sharapova »

Il y a les indémodables, comme les amphétamines, l’EPO ou les hormones de croissance. Et il y a les autres produits, qui connaissent leur heure de gloire. En cette période automne-hiver, la dernière mode semble être le meldonium, médicament phare des pays de l’Est, interdit depuis le 1er janvier. Il favorise l’oxygénation musculaire. Un intérêt pour les personnes souffrant d’un apport sanguin insuffisant. Ce pourquoi Sharapova prétend utiliser le médicament. Comme elle, 99 sportifs professionnels auraient été contrôlés positifs au meldonium depuis le 1er janvier. Difficile de croire que ces athlètes, russes dans leur quasi-totalité, souffrent tous de problèmes cardiaques. Mais Sharapova affirme aussi consommer du meldonium pour combler « un déficit en magnésium et prévenir le diabète ». Pourtant, le meldonium n’est susceptible de ne traiter qu’un seul des problèmes avancés par Maria Sharapova, ce qui remet en question les excuses de la Russe. Et même si Sharapova a fait preuve de maladresse, cette méconnaissance des sportifs, aussi bien des règles antidopage que des produits qu’ils ingèrent, reste préoccupante.
L’ITF, spécialiste du mensonge par omission ?
Habituellement, dans les différents sports, les fédérations internationales sont les premières à communiquer sur les contrôles positifs de leurs athlètes. C’est pourquoi la conférence de presse de Maria Sharapova pourrait étonner. Mais dans le monde de la petite balle jaune, l’ITF n’a pas l’habitude de s’étendre sur ces cas de dopage. Car si le Code antidopage de l’AMA (agence mondiale antidopage) pousse les fédérations à sanctionner leurs athlètes, elles ne les contraignent pas à publiciser les affaires. Un point dont l’ITF est aujourd’hui la dernière fédération à profiter pleinement, et dont elle ne se cache pas : « L’ITF ne se prononce que lorsqu’un joueur est reconnu coupable de dopage par un tribunal compétent ». Et encore ! L’affaire Cilic témoigne que l’ITF ne se donne pas toujours cette peine. En 2013, le joueur croate, alors 15ème mondial, avait été suspendu pour trois mois suite à un contrôle positif, dû à sa négligence. Marin Cilic avait préféré évoquer une blessure pour justifier sa tenue à l’écart des courts. Une version jamais démentie par l’ITF. Il aura fallu les révélations de la presse croate, appuyées par l’ancien entraîneur du joueur pour découvrir la supercherie. Trois ans après l’affaire, il reste toujours impossible de savoir à quel produit Cilic avait été testé positif, tant l’opacité semble être le maître mot de l’ITF.

Pour mieux préserver une image lisse de ses joueurs, et ne pas mettre un péril les intérêts économiques d’un sport où les dotations, ancrées dans la culture tennistique, montrent à quel point l’argent est central.

S’il paraît nécessaire de faire sauter les tabous en matière de dopage, il est clair que ce n’est pas du tennis que viendra le salut. Aujourd’hui, face au cas Sharapova, chaque joueur est publiquement plus suspect que jamais : Nadal pour son jeu puissant et physique, Roger Federer pour sa longévité, Novak Djokovic pour sa domination, et chacun a son avis sur la question. Des spéculations qui vont bon train, sans preuve, mais que l’ITF a largement provoquées. Car à force d’opacité, le tennis ne s’expose qu’à une chose : faire que chaque période d’inactivité d’un joueur devienne suspecte.
Emmanuel Durget