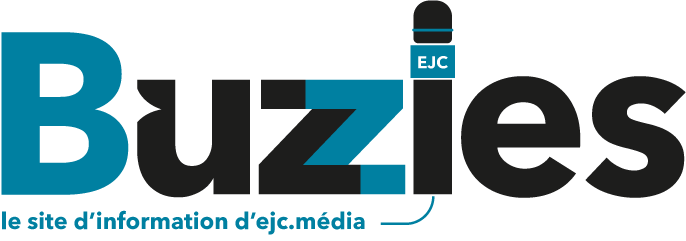De décembre à mars, les mimosas en fleurs illuminent les collines de Mandelieu-la-Napoule. Pourtant, d’année en année, les mimosistes s’y font de plus en plus rares.

« Des mimosas ? Il y a encore 20 ans, la colline en était couverte ! ». D’un geste large, Roger Cometti désigne la colline du Capitou qui surplombe Mandelieu. Ici, à l’instar des arbres jaunes, les mimosistes ont peu à peu disparu du paysage. Alors qu’ils étaient plus de soixante dans les années 80, ils ne sont plus que trois aujourd’hui.
La nature a ses raisons
Mimosiste jusque dans les années 80, Roger Cometti a incarné, avec son frère Georges, la troisième génération de mimosistes de la famille. Désormais paysagiste à la retraite, il explique que « c’est la vague de froid de 1956 puis l’incendie de 1970, qui ont d’abord poussé les mimosistes à arrêter ». Les aléas naturels ne justifient pas à eux seuls ce phénomène. Pour Roger Cometti, l’introduction d’autres plantes sur le marché aurait fait ombrage au mimosa : « La plantation d’anémones à Antibes a fait baisser la production, comme le succès de l’eucalyptus, exporté en Angleterre, en Amérique, en Hollande ». Ainsi, d’après le plan local d’urbanisme (PLU) de la ville, « l’agriculture mandolicienne-napouloise subit une véritable déprise depuis les années 1960 qui se poursuit encore actuellement ».
Une profession en crise
Emilie Oggero et Fréderic Bardelli appartiennent à deux des plus vieilles familles de mimosistes de Mandelieu. Pour eux, la raréfaction des professionnels du mimosa est en partie due au fait que beaucoup de nouvelles générations n’ont pas repris l’entreprise familiale. Le métier est réputé difficile et susceptible de décourager les débutants : l’achat d’un terrain ou la construction d’une forcerie demandent notamment de gros investissements. Ainsi, bien que le mimosa représente encore un des trois grands secteurs agricoles qui « subsistent » à Mandelieu – à côté des maraîchers de la Siagne et du domaine viticole de Barbossi – depuis 30 ans, le végétal n’a cessé de perdre du terrain : « depuis 1988, les trois-quarts des exploitations ont disparu et la surface agricole utile a diminué de 40% », indique le PLU (2012).
Des villas à la place du mimosa
Sur la colline du Capitou, les hectares fleuris ont laissé place aux terrains à bâtir. Dans les années 70, Roger Cometti lui-même a érigé sa maison sur un terrain jusqu’alors dédié à la culture du mimosa. D’après Emilie Oggero, l’appât du gain aurait poussé la mairie à rendre constructibles de nombreux terrains dédiés au mimosa. « Un immeuble rapporte plus qu’un plan de mimosa » déplore-t-elle. Ainsi, bien que les massifs du Tanneron et de l’Esterel soient aujourd’hui en grande partie protégés, la pression immobilière très forte sur la Côte d’Azur laisse perplexe la mimosiste : « au rythme où ça va », Emilie Oggero se demande combien de temps encore Mandelieu pourra se dire « capitale du Mimosa ».
Eden Armant-Jacquemin