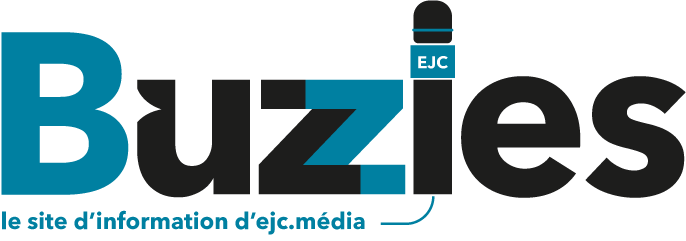Dimanche dernier à cinq heures du matin, l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz (Iran) subissait une explosion. Selon l’Agence France Presse (AFP), « les informations disponibles sont parcellaires et les éléments communiqués par les autorités iraniennes parfois contradictoires ». L’attaque, ayant eu lieu en interne, laisse à croire un sabotage. C’est la piste qu’a préféré privilégier la diplomatie iranienne, qui accuse Israël. Ces nouveaux événements viennent s’inscrire dans une discussion internationale sur le nucléaire iranien.

Alors que l’Europe dormait encore dimanche dernier, l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz, en Iran, connaissait un violent évènement. Une explosion a lieu, « dans un fourreau de câbles électriques ». Dans la journée, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) reconnait une « petite explosion », dont les dégâts seraient rapidement réparables. « Les centrifugeuses, alimenté par les câbles touchés, ont été endommagés », a déclaré mardi dernier Ali Rabii, le porte-parole du gouvernement iranien. Il ajoute : « Ce n’était pas une attaque externe et l’endroit du sabotage a été clairement établi ».
Une escalade des tensions
Cet incident prend place en plein cœur de la problématique du nucléaire iranien. Selon l’accord international de Vienne de 2015, l’Iran est autorisé à produire de l’énergie nucléaire, sous plusieurs conditions. Pendant quinze ans, l’uranium traité dans ses centrales ne doit pas excéder 3,67% en isotope 235 après son enrichissement. Jusqu’en 2025, l’Iran ne pourra pas posséder plus de 5060 centrifugeuses de première génération IR-1. La production d’énergie nucléaire doit aussi s’effectuer sur le seul site de Natanz, au nord de la ville d’Isfahan. Or le 8 mai 2018, Washington se retire de cet accord, Donald Trump le qualifiant de « pire accord jamais négocié », potentiellement déclencheur d’un « holocauste nucléaire ». Le lendemain, la Maison Blanche accuse officiellement l’Iran d’avoir violé l’accord à de nombreuses reprises.
En réponse, l’Iran ne se cache plus et débute un désengagement de l’accord en mai 2019. À partir de janvier 2021, Téhéran produit de l’uranium enrichi jusqu’à 20%, loin des 3,67% imposés en 2015. Cette annonce inquiète les autres puissances mondiales, qui demandent à l’Iran de ne prendre « aucune mesure supplémentaire de désengagement » en février. Le pays s’enhardit en annonçant, moins de vingt-quatre heures avant l’explosion du 11 avril, qu’il va mettre en service des centaines de centrifugeuses interdites par l’accord de Vienne. Deux jours après « l’attaque », le ministre iranien des Affaires étrangères adjoint Abbas Araghchi annonce que le gouvernement s’apprête à produire de l’uranium enrichi à 60%, palier tremplin pour atteindre les 90% nécessaires pour une utilisation militaire selon l’AFP.

Un effort presque international
L’incident du 11 avril est considéré par Téhéran comme un sabotage. Cette déduction s’explique par l’explosion « terroriste » ayant frappé une autre usine du même site en juillet 2020, d’origine inconnue. Pour l’heure, la diplomatie iranienne accuse Israël, ennemi de toujours de la République islamique, et prévoit une « vengeance ». Le président Rohani présente l’enrichissement de l’uranium à 60% comme une réponse au « terrorisme nucléaire israélien ». Le New York Times évoque une possible responsabilité des États-Unis, démentie par le pouvoir.
Le 6 avril ont débuté des pourparlers pour faire réintégrer Washington à l’accord de Vienne, ce que Joe Biden a déclaré souhaiter. Ce retour pourrait faire changer bien des choses : la Russie, en se plaçant du côté de l’Iran, exige que : « Toutes les sanctions unilatérales prises à Washington en violation directe de l’accord doivent être annulées » (Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe). Ce dernier s’était montré optimiste lors d’un point presse à Téhéran, en déclarant : « Nous tablons sur le fait qu’on pourra sauvegarder l’accord et que Washington reviendra enfin à (sa) mise en œuvre pleine et entière. »
Quant aux puissances occidentales, le respect strict de l’accord de Vienne par la République islamique est une condition incontournable pour continuer à traiter pacifiquement.
Le jeudi 15 avril s’est tenue la réunion entre l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et l’Iran, initialement prévue le mardi précédent, alors que les conservateurs iraniens réclamaient l’arrêt de ces discussions (AFP). L’ambassadeur russe en Autriche Mikhail Ulyanov a ressenti une « impression générale positive », tandis que le coordinateur de l’Union européenne Enrique Mora se réjouissait de l’aboutissement de l’évènement. L’Iran, qui depuis le vendredi 16 avril produit de l’uranium enrichit à 60%, a annoncé dans un communiqué qu’il refuserait toutes négociations qui « traîneraient en longueur ».
Samuel Gut