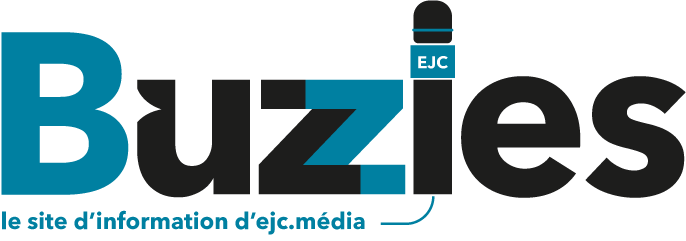La question de la laïcité et de la place des religions dans la société française ne cesse d’agiter le débat politique et intellectuel. Entre une vision stricte et une vision libérale qui se veut plus compréhensive, la laïcité divise et crée polémiques et controverses.
La laïcité, selon sa définition première, est une conception fondée sur la séparation claire de l’Église et de l’État. Cette dernière dispose d’un cadre législatif exposé dans l’article premier de la Constitution française de 1958. À savoir que la France est le seul pays de l’Union Européenne à avoir intégré le principe de laïcité dans sa Constitution. Elle incarne donc un fondement de la République française et repose principalement sur deux principes : l’obligation de l’État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion.
La laïcité a pour objectif de rassembler les individus d’une même société dans un cadre commun, et non les faires se ressembler, c’est-à-dire de tendre vers l’uniformisation de la société. La laïcité française est prise dans cette ambiguïté. Le problème apparaît quand des individus revendiquent la « vérité » de leur religion avec intolérance au regard des autres. Cela peut les pousser à s’opposer aux lois de l’État qui assurent la sécurité et les libertés des individus.
La loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État avait fixé deux grands principes : un principe de liberté (la République assure la liberté de conscience) et un principe de séparation (la République ne reconnaît et ne finance aucun culte). Ces deux repères avaient permis de trouver un équilibre sur la place des religions en France au cours du XXème siècle. Le climat était apaisé.
Entre laïcité “stricte” et laïcité “libérale”
Le développement de l’islam en France et en Europe est venu rouvrir un débat qui s’est focalisé sur la question du port du voile. En 1989, deux jeunes filles sont exclues de leur collège parce qu’elles refusent d’ôter leur voile. De telles affaires vont se multiplier jusqu’en 2004 quand la loi va interdire les signes religieux ostensibles à l’école. Adopté à une écrasante majorité, le texte manifeste une sorte de consensus républicain. Mais la menace islamiste et plusieurs vagues d’attentats comme celui des Tours Jumelles à New York en 2001, ceux de Paris, de Charlie Hebdo et Hyper-cacher en 2015 ou la mort de Samuel Paty en 2020 ont réveillé brutalement les controverses.
Une partie de l’extrême droite associe l’intégrisme islamiste à la religion musulmane qui serait en soi, “incompatible” avec les valeurs républicaines. De l’autre côté, des associations musulmanes et une partie d’extrême gauche voient dans toute critique de l’islam une forme de discrimination. Entre ces deux postures, l’attitude des politiques, qu’ils soient de gauche, du centre ou de droite, se résume en deux approches. L’une veut faire de la laïcité un bouclier contre les religions dont ils dénoncent l’influence croissante. Outre le refus de tous signes religieux au travail comme à l’université, des associations laïques attaquent en justice l’installation de crèche de Noël dans une mairie ou réclament la fin des émissions religieuses dans l’audiovisuel public. Les tenants de cette laïcité « bouclier » veulent cantonner la religion à la vie privée et restreindre toute expression dans l’espace public.
L’autre approche considère que la laïcité est d’abord un principe de liberté et que les religions participent comme d’autres institutions à la vie publique et au bien commun. Une vision beaucoup plus libérale et tolérante qui envisage ainsi la laïcité comme un régime de liberté individuelle et civile. « La vision libérale a longtemps prévalu dans les partis de gouvernement, et jusque récemment à gauche », rappelle Philippe Portier, chercheur au CNRS, spécialiste de la laïcité. « Mais la situation a changé, notamment après les attentats de 2015. Un discours sécuritaire très ferme et une rhétorique jusque-là cantonnée à l’extrême-droite se sont répandus. Et aujourd’hui, la laïcité stricte a pris l’avantage ».
Élément de conflit plutôt que de concorde
Cette opposition entre laïcité stricte et laïcité libérale s’invite donc inévitablement jusque dans les plus hautes sphères du politique. C’est un thème qui a d’ailleurs été un des sujets marquants du dernier débat d’entre-deux tours entre le Président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen, ayant occupé environ 13 minutes des près de trois heures de débat. Les deux candidats ont marqué une stricte divergence à ce sujet, notamment sur le port de signes extérieurs de religion (et surtout le voile). Marine Le Pen souhaite interdire le port du voile dans l’espace public, afin de lutter contre l’idéologie islamiste (qu’elle a tenu à différencier de l’islam). Emmanuel Macron, considérant « le foulard » comme un simple signe extérieur de religion au même titre que la kippa dans la religion juive, n’en fera rien. Il colle ainsi à ce qu’il avait déjà dit en 2019 lors d’un débat avec des intellectuels, pour lui, la laïcité, « c’est la loi de 1905, rien que la loi de 1905 ». Valentine Zubler, historienne et directrice d’étude à l’Ecole pratique des hautes études, explique dans les colonnes de Libération, que, de son côté, « Marine Le Pen instrumentalise la laïcité sur ces deux thématiques particulières : la sécurité et l’identité nationale. Sa laïcité n’est pas une laïcité de droit ou de liberté. C’est une laïcité de contrôle ».
67% des français pensent que « la laïcité est trop souvent instrumentalisée par les personnalités politiques », selon une enquête de Viavoice pour l’Observatoire de la laïcité. Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité et ancien ministre, déclare dans le livre En finir avec les idées fausses sur la laïcité de Nicolas Cadène que la laïcité est transformée « en élément de conflit ou de division, alors qu’elle devrait être un élément de concorde ». Il précise que « s’il y aura toujours des débats d’idées sur la laïcité et une multitude d’interprétations intellectuelles à son sujet, il n’y a, en droit, qu’une seule laïcité qui s’applique ».
Même si les débats sociaux et politiques peuvent attiser la confusion et rendre la situation parfois ambiguë, « au moins, il y a cette répartition claire depuis le début du XXe siècle » explique Frère Marie, moine cictercien à l’Abbaye de Lérins. Même si lui et sa communauté vivent ancrés dans la religion catholique, il reste très favorable à la laïcité, qu’il considère comme « importante ». Pour lui « une laïcité bien comprise, c’est le respect de la liberté des consciences, de choisir » et déplore « la période où cela s’est focalisé sur un conflit laïque et antireligieux ». Il est allé voter à l’élection présidentielle et même si « c’est dissocié, la foi et l’évangile […] permet[tent] d’ajuster [ses] choix, d’avoir [son] critère de discernement, de réflexion, de jugement ». Comme le confirme le site laicite.gouv,« la laïcité garantit la liberté de conscience. La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres mais la liberté d’en avoir une ».
Le projet Religaere
Maxime Conchon, Bastien Dufour, Laura Hue, Valentine Brevet & Noah Bergot